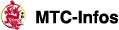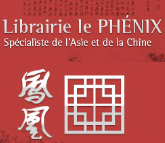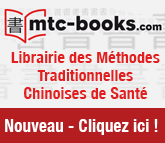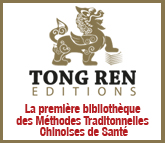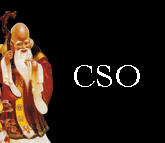L’esprit fondamental de la philosophie du Tao est de trouver l’essentiel. Ainsi la voie naturelle des anciens taoïstes dresse un pont entre l’être ordi- naire et de vastes potentialités, souvent ignorées. C’est pourquoi ce chemin spirituel et philosophi- que ne présente aucune difficulté d’adaptation aux différentes époques et à la diversité des cultures. Avant de définir le sens du mot Tao (Dao en pi- nyin) dressons un bref inventaire de ce qu’il n’implique pas.
Le Tao ne se définit nullement comme :
• une philosophie panthéiste matérialiste,
• une séquelle du chamanisme animiste,
• une pensée hédoniste et conciliante,
• une école basée principalement sur des pratiques eugéniques et hygiéniques.
Ces idées reçues sur la philosophie du Tao nous mettent en garde contre une tentative hâtive d’interprétation, ce qui serait un moindre mal, ou de récupération plus malhonnête intellectuelle- ment. Les sinologues n’ont pas facilité les choses par leur choix répétitif des textes commentés (cf le sempiternet Dao De Jing).
La traduction controuvée du terme “Qi” par souf- fle n’en est qu’un triste exemple. Quelle est donc la signification du mot Tao ? Il a le même sens que le mot Giulu signifiant : les règles, et du mot Daolu, la voie ou le chemin.. En fait, son sens profond exprimé par les anciens sages est celui de “ chemin menant fermement à la racine des choses ”.
Lao Zi et la voie de l’eau
Le maître taoïste contemporain Hié Tsai Yang de Taïwan considérait toujours Lao Zi (Lao Tseu) comme une référence, mais non comme un point de départ de l’étude de la philosophie du Tao. Il déclarait que le célèbre classique, le Daode Jing (Tao Te King), était en fait inintelligible, sans un commentaire verbal d’un maître taoïste. Cela ex- plique la diversité, voire l’opposition des nom- breuses traductions disponibles de ce texte majeur de la philosophie du Tao.
Ce livre de sagesse est une introduction au calme créatif – le Wuwei – une action sans effort afin d’atteindre l’équilibre et la force intérieure. Lao Zi décrit l’harmonie qui en résulte, en particuliers la conciliation du Yin et Yang sur la base d’un poten- tiel spirituel élevé. L’équanimité et l’harmonie intérieure sont les conséquences du parcours de la voie naturelle prônée par Lao Zi, exprimée en une allégorie politique. Le sage décrit dans cet ouvrage se fond dans l’ordre naturel des choses, et l’évolution de la société provient du changement des individus et non de l’application des règles établies, comme le préconise Confucius. L’homme tire ainsi sa force de la nature et du développe- ment de l’énergie vitale, sans partager la concep- tion animiste des shamans de la Chine antique.
Le Daode Jing propose ainsi concrétement deux manières d’entretenir la vie spirituelle : le travail direct sur l’énergie (Le Qi de la médecine chinoise), et le détachement des phénomènes mon- dains, qui obscurcissent la conscience et brûlent la
santé dans le feu des émotions conflictuelles. Plus tard, les taoîstes nommeront ce trvail : la voie de l’eau en oppoistions aux méthodes de l’alchimie interne (Neidan) de la voie du feu.
L’alchimie intérieure, voie du feu
Les siècles qui ont suivi l’enseignement des trois sages (Lao Zi, Zhuang Zi et Li Zi) ont parfois été perçus comme une déviation du taoïsme originel; cependant le point de vue des lettrés occidentaux n’est aucunement celui des taoïstes eux-mêmes.
Dès le IIIème siècle le taoïsme est devenu une philosophie pratique et appliquée. On peut y trouver indubitablement l’origine des pratiques du Qigong moderne, comme l’a souligné le sinologue Joseph Needham.
L’application de la voie fleurit dans la médecine et la pratique de l’alchimie. Dès la dynastie des Qin (221-207 avant J-C.) des taoïstes pratiquaient la chimie des substances médicinales sous la forme d’élixirs, à la cour de l’empereur Shi Huang Ti. Les confucianistes considéraient d’un mauvais oeil ces recherches, qui pourtant firent progresser la médecine chinoise.
Les méthodes d’hygiène, de diététique et de respiration fleurirent dès cette époque et constituent l’essentiel du Daozang (Tao Tsang), le canon taoïste composé de centaines de recueils d’auteurs différents. Le but déclaré de la voie taoïste est d’atteindre l’état de Xian ou « d’ immortel ».
Ce terme a donné lieu en Chine et ailleurs à de nombreuses interprétations et polémiques. Le Xian est un sage qui a parcouru la voie et pratiqué le Xiudao, le chemin conforme au Tao. Son esprit est éveillé, son énergie abondante et il peut affronter la mort en sachant que sa conscience va rester lucide.
Quant à considérer qu’il ne mourra point, c’est une légende entretenue par la religion populaire. Les sages taoïstes pensent en effet que la mort et le changement sont inévitables. Cet éclectisme reste une caractéristique de la voie naturelle du Tao. En fait, diverses sciences traditionnelles sont utilisées pour arriver à un objectif universel.
Cultive les neuf champs de connaissance
les aliments, les plantes médicinales, l’habitat écologique, la lecture de textes sacrés, les exercices énergétiques, la méditation, la créativité spirituelle, l’enseignement , et surtout... la compassion.
Leur approche naturelle de la physiologie énergétique amena les sages du Tao à poser les bases de ce que l’on nomme aujourd’hui médecine traditionnelle.
La connaissance des réseaux d’énergie subtile, les Jing Luo, et l’interrelation entre les émotions et les maladies ; la maîtrise des Qi internes ....
Gérard Edde
(extrait lire la suite ):
http://www.federationqigong.com/fichiers/file300.pdf